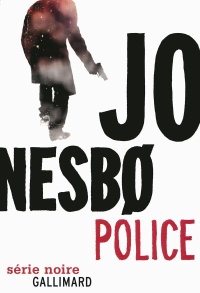Dans un thriller a priori très convenu, l’écrivain norvégien Jo Nesbø croise discrètement le fer idéologique avec son confrère suédois Stieg Larsson, et la société de surveillance généralisée introduite par l’obsédante pratique du hacking.
Annoncé à grands renforts de publicité comme le dernier livre du « maître du polar norvégien », Police, de Jo Nesbø, devrait rencontrer un certain succès éditorial et continuer à se hisser toujours plus haut sur la liste des meilleures ventes. Il faut dire que tous les ingrédients marketing sont là, et d’abord l’aspect extérieur : un pavé de 600 pages, promesse qu’on en aura pour notre argent (21 euros). Une multitude de personnages, toujours bien campés et facilement identifiables (du détail physique au trait de caractère). La figure récurrente du héros aux prises avec ses propres démons (Harry Hole et l’alcool). Des crimes abominables et des corps suppliciés (tuer ne suffit pas, il faut démolir les corps jusqu’à l’insoutenable). L’adroit mélange des plus folles extravagances narratives et du réalisme le plus précis (le bruit d’une machine à café Nespresso associé aux noms et couleurs des capsules de la même marque, qui n’est pas sans rappeler le « placement d’objets » cher au cinéma actuel). Des situations angoissantes où rode la menace et dont le suspense s’achève en pirouette (le coup « d’une présence que l’on devine dans la maison censée être déserte, mais qui n’était, en fait, qu’un chat dans le placard », est ici recyclé, avec dans le rôle du bruit, une odeur, dans le rôle du chat, un blaireau, et dans le rôle du placard, un faux-plafond). Police est donc un parfait thriller, déroulant ses rebondissements multiples avec une efficacité convenue. Hollywood n’aura pas besoin d’adapter le roman, Jo Nesbø nous fait déjà son cinéma — façon blockbuster mainstream.
Police s’inscrit également dans les clous du polar nordique, avec cette étrange manie qu’ont les auteurs scandinaves de présenter leurs villes, pourtant les plus sûres et les plus morales du monde, comme des repères de mafieux, de politiciens corrompus et de jeunes gens désaxés. Qu’on se le dise : Naples et Marseille n’ont qu’à bien se tenir car, en matière de criminalité organisée et de corruption, Oslo tient la corde. Ainsi Jo Nesbø ne craint pas, dès les toutes premières pages, de présenter la capitale norvégienne comme l’une des villes les plus atteintes par la drogue et les overdoses. Une telle affirmation laissera perplexe même celui qui n’a de la capitale norvégienne qu’une connaissance succincte. Cette manie scandinave est assez mystérieuse : s’agit-il seulement de jouer à se faire peur ? De témoigner d’un désenchantement moderne, vaguement masochiste ? D’une peur de changements possibles ? Ou d’un narcissisme collectif, d’une coquetterie, à l’image de ces mannequins qui devant un miroir se jugent à voix haute « énormes », de préférence devant une assistante qui a vraiment un problème de surpoids ?
Devant une telle avalanche de figures convenues et un si scrupuleux respect des codes du genre, le critique a le choix : soit s’émerveiller de la virtuosité de l’auteur en se disant que le public de toutes manières attend cela, soit assumer son rôle de pisse-froid et avouer son ennui… prolongé. Face à ce gros roman publié en France par un major de l’édition (Gallimard), on éprouve ainsi de la nostalgie pour ces temps héroïques où le quasi-inconnu Nesbø signait ses talentueux Rue Sans-Souci et Rouge-Gorge chez Gaïa, cet éditeur pionnier de la littérature nordique en France. Le temps est loin où…
Et c’est ici, sur cette question de l’air du temps, que le roman se rattrape. On le sait bien : tout polar a deux énigmes, l’une sous forme d’un puzzle (l’élucidation du crime), l’autre en filigrane (le message de l’auteur).
Avec efficacité et beaucoup d’à-propos, Police nous plonge en effet dans le monde d’une surveillance totale, celui où le Big brother du policier s’accouple au Big data de l’ingénieur. Dans notre modernité, tout est désormais traçable, nous rappelle avec insistance l’auteur. Faut-il vérifier que tel suspect a des liens avec tel inspecteur au dessus de tout soupçon… Les relevés de cartes de crédit montrent alors qu’ils ont dîné à plusieurs reprises dans les mêmes restaurants (et qu’ils ont visiblement partagé la note, détail très scandinave). Tel suspect dispose d’un alibi, il existe quelque part sur un serveur informatique un enregistrement des relevés de caméras de surveillance prouvant effectivement son innocence. L’enregistrement a-t-il été effacé ? On pourra toujours l’extraire du disque dur et le reconstituer. Contrairement à la mémoire humaine qui hiérarchise et valorise, et fait de sa défaillance, histoire, cette mémoire électronique est sans oubli.
Avec beaucoup d’intelligence tactique, le romancier décrit cet univers orwellien de manière neutre : dans Police la technique accuse autant qu’elle disculpe; elle n’est pas nécessairement au service d’une punition généralisée. Elle n’est pas un dispositif brutal et aveugle – au contraire : la technique voit tout, entend tout, démonte et démontre tout. Évitant ainsi le prêche moralisateur et finalement rassurant, le romancier décrit froidement l’inquiétante omniscience… de la science, et le règne de la transparence de tous vis-à-vis de tous.
Là où, il y a quelques années et avec une légèreté qui nous laisse aujourd’hui pantois, Stieg Larsson s’émerveillait des exploits cybernétiques d’une adolescente rebelle et transgressive (l’héroïne Lisbeth Salander, si politiquement correcte), Jo Nesbø décrit froidement un travail policier où, d’un clic-droit, l’enquêteur-hacker accède à la liste de vos derniers achats, au contenu des vidéos regardées un jour ou l’autre, dévoilant autant l’emploi du temps du collègue que les désirs secrets et non réalisés du quidam-suspect, forcément suspect… Et pour que tout soit clair dans cette référence à Millenium et ce « dialogue » entre romanciers, Nesbø reprend et transpose la figure singulière de l’enquêtrice douée d’une mémoire absolue des visages. Comme un serial killer, Jo Nesbø signe ainsi son acte littéraire pour qui saura le décrypter.
Dans le livre, personne ne s’émeut de cette transparence du monde où l’autre n’a plus de secrets pour quiconque; personne, pas même le narrateur, aussi neutre et dépourvu de valeurs que l’est la société de l’Internet et des réseaux. C’est sans doute le message en creux de l’auteur : au citoyen de s’emparer de ces sujets, et de sortir de cette acceptation généralisée du regard inquisiteur de tous sur tout. Si Police est dans l’air du temps, c’est aussi, surtout, vent-debout.
Police, de Jo Nesbø, traduit du norvégien par Alain Gnaedig,éditions Gallimard, 606 p. 21 euros.